Au lendemain de la clôture de la 17ème Conférence des parties à la convention climat, il est difficile de savoir s’il faut être satisfait ou, une fois de plus déçu. La disparité des bilans dressés par les commentateurs avisés ne fait qu’accroitre le trouble…
La décision prise le 13 décembre par le Canada de quitter le protocole de Kyoto révèle la vraie nature de l'accord de Durban : une feuille de route vide de sens qui constitue une échappatoire à toute forme d'engagement contraignant.

Reconnaissons que Durban n’est qu’une étape sur un long chemin et qu’il faut, pour juger de l’efficacité d’une négociation aussi complexe que l’élaboration d’un accord international pour lutter contre le changement climatique, considérer la succession des différentes séquences.
Le sentiment d’échec après Copenhague découlait du constat de l’incapacité des négociations à résoudre les deux défis majeurs de la gouvernance mondiale du climat :
- Le trop faible niveau des engagements des pays industrialisés - autant en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), que de promesses de transferts financiers vers les pays en développement pour les aider à faire face au double défi de l’atténuation et de l’adaptation ;
- L’absence d’accord sur l’architecture juridique du futur régime climatique, devant remplacer le protocole de Kyoto après 2012.
Si Cancun a remis la machine multilatérale en route, nous n’avons à Durban, deux ans après Copenhague, progressé significativement sur aucun de ces deux grands enjeux.
Le sentiment d’échec après Copenhague découlait du constat de l’incapacité des négociations à résoudre les deux défis majeurs de la gouvernance mondiale du climat :
- Le trop faible niveau des engagements des pays industrialisés - autant en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), que de promesses de transferts financiers vers les pays en développement pour les aider à faire face au double défi de l’atténuation et de l’adaptation ;
- L’absence d’accord sur l’architecture juridique du futur régime climatique, devant remplacer le protocole de Kyoto après 2012.
Si Cancun a remis la machine multilatérale en route, nous n’avons à Durban, deux ans après Copenhague, progressé significativement sur aucun de ces deux grands enjeux.
Des engagements de réduction très insuffisants
Les engagements sont toujours notoirement insuffisants. Ils ne représenteraient aujourd’hui que 60% de l’effort à produire pour contenir le changement climatique. Dès lors, la plupart des pays vulnérables ont quitté Durban très inquiets, considérant que le scénario actuel conduirait à un réchauffement global de 4°C, voire plus, c’est à dire au delà du seuil de « viabilité » pour l’humanité. Les ONG ont massivement dénoncé cette insuffisance d’engagements soulignant le déficit croissant d’équité du système international qui condamne de plus en plus inéluctablement les plus vulnérables. Il va maintenant falloir attendre les nouvelles projections du GIEC qui ne seront pas disponibles avant le prochain rapport, prévu en 2014.
Les engagements sont toujours notoirement insuffisants. Ils ne représenteraient aujourd’hui que 60% de l’effort à produire pour contenir le changement climatique. Dès lors, la plupart des pays vulnérables ont quitté Durban très inquiets, considérant que le scénario actuel conduirait à un réchauffement global de 4°C, voire plus, c’est à dire au delà du seuil de « viabilité » pour l’humanité. Les ONG ont massivement dénoncé cette insuffisance d’engagements soulignant le déficit croissant d’équité du système international qui condamne de plus en plus inéluctablement les plus vulnérables. Il va maintenant falloir attendre les nouvelles projections du GIEC qui ne seront pas disponibles avant le prochain rapport, prévu en 2014.
Un fonds vert sans ressources
L’autre enjeu important en matière d’engagement était de donner vie au Fonds Verts évoqué à Cancun pour aider la transition rapide des pays en développement vers des stratégies d’atténuation et surtout d’adaptation. L’urgence de ces aides est encore accrue par la perspective d’un changement climatique plus brutal et plus violent du fait même des échecs répétés de négociations qui se suivent et malheureusement se ressemblent trop.
La aussi, certains observateurs arrivent à se satisfaire d’un accord qui officialise la constitution de ce Fonds Verts. Certaines contributions financières ont même été annoncées. Il semblerait qu’elles permettront de financer le fonctionnement du Fonds sur ses deux premières années. Mais a quoi servirait de faire fonctionner un Fonds s’il n’est pas doté de crédits suffisants. Car nous sommes loin des attentes exprimés à Cancun. Aucune perspective sérieuse n’a été avancée à Durban pour doter ce mécanisme des 100 milliards d’Euro dont il aurait besoin chaque année. 100 milliards c’est le montant annuel de l’aide publique au développement et les pays les plus vulnérables s’alarment légitimement d’un possible transfert de ressources des aides classiques, très souvent indispensables, vers ce Fonds Verts. Cela reviendrait à déshabiller Jacques pour habiller Paul… Mais 100 milliards ce n’est qu’un 7ème du marché mondial de l’armement, ce n’est qu’un 5ème du chiffre d’affaire mondial de l’industrie de la publicité, ce n’est qu’un quart des subventions publiques attribuées au développement des énergies fossiles, ce n’est qu’une fraction des plus values effectuées sur les transactions financières.
L’autre enjeu important en matière d’engagement était de donner vie au Fonds Verts évoqué à Cancun pour aider la transition rapide des pays en développement vers des stratégies d’atténuation et surtout d’adaptation. L’urgence de ces aides est encore accrue par la perspective d’un changement climatique plus brutal et plus violent du fait même des échecs répétés de négociations qui se suivent et malheureusement se ressemblent trop.
La aussi, certains observateurs arrivent à se satisfaire d’un accord qui officialise la constitution de ce Fonds Verts. Certaines contributions financières ont même été annoncées. Il semblerait qu’elles permettront de financer le fonctionnement du Fonds sur ses deux premières années. Mais a quoi servirait de faire fonctionner un Fonds s’il n’est pas doté de crédits suffisants. Car nous sommes loin des attentes exprimés à Cancun. Aucune perspective sérieuse n’a été avancée à Durban pour doter ce mécanisme des 100 milliards d’Euro dont il aurait besoin chaque année. 100 milliards c’est le montant annuel de l’aide publique au développement et les pays les plus vulnérables s’alarment légitimement d’un possible transfert de ressources des aides classiques, très souvent indispensables, vers ce Fonds Verts. Cela reviendrait à déshabiller Jacques pour habiller Paul… Mais 100 milliards ce n’est qu’un 7ème du marché mondial de l’armement, ce n’est qu’un 5ème du chiffre d’affaire mondial de l’industrie de la publicité, ce n’est qu’un quart des subventions publiques attribuées au développement des énergies fossiles, ce n’est qu’une fraction des plus values effectuées sur les transactions financières.
Un futur régime : trop tard et probablement trop faible
Concernant le futur régime climatique, les observateurs les plus optimistes se réjouissent de l’adoption d’une feuille de route pour produire un nouvel accord qui devra rentrer en vigueur en 2020. Les moins enthousiastes rappellent que le principe d’une deuxième période d’engagement était déjà inscrit au Protocole de Kyoto lors de sa signature en 1997. Ils soulignent qu’à Bali en 2007, deux options avaient été mises en chantier pour donner suite à ce Protocole. Ils mentionnent qu’en 2009, à Copenhague, tout devait être fait pour arrêter les contours de ce nouvel accord…
Mais surtout, ils pointent le fait si l'accord doit intervenir pour 2015, son entrée en vigueur n'est pas prévue avant 2020. Ce calendrier ne permettra pas de limiter le réchauffement à 2°C, puisqu’on manquera la fenêtre d’opportunité pour inverser dès maintenant la tendance, contenir le pic des émissions vers 2015, pour entamer ensuite une décroissance continue jusqu’en 2050. Plus nous retardons la mise en mouvement, plus les efforts à produire seront difficiles à tenir au risque de manquer la cible de moins en 50 % en 2050, signifiant un facteur 4 de réduction pour les pays industrialisés.
Qui plus est, l’accord sur cette feuille de route, reste entaché de très nombreuses incertitudes. Alors que l’Union européenne militait pour un dispositif légalement contraignant, le texte de Durban ouvre trois options : un nouveau protocole ; un instrument légalement contraignant ou un simple « acte juridique ». Outre le temps qui sera encore perdu pour comprendre ce que signifie chaque option et pour en choisir une parmi les trois, il faut craindre que, dans la dynamique de négociation dégradée depuis Copenhague, il sera difficile d’aller au delà de l’option la faible. 2020 verrais alors l’adoption d’un « acte juridique » qui au mieux enregistrera la réalité des réductions des différents pays au regard des engagements pris par les pays signataires. Mais que pourra bien être la portée d’un tel instrument, déconnecté de toute contrainte et de toute sanction. L’observation des relations internationales démontre pourtant que les seuls accords qui comptent vraiment en terme d’engagement sont ceux promulgués par l’OMC, parce que justement ils s’adossent à l’Organe de Règlement des Différends qui juge, émet des sanctions commerciales et veille à leur application.
Concernant le futur régime climatique, les observateurs les plus optimistes se réjouissent de l’adoption d’une feuille de route pour produire un nouvel accord qui devra rentrer en vigueur en 2020. Les moins enthousiastes rappellent que le principe d’une deuxième période d’engagement était déjà inscrit au Protocole de Kyoto lors de sa signature en 1997. Ils soulignent qu’à Bali en 2007, deux options avaient été mises en chantier pour donner suite à ce Protocole. Ils mentionnent qu’en 2009, à Copenhague, tout devait être fait pour arrêter les contours de ce nouvel accord…
Mais surtout, ils pointent le fait si l'accord doit intervenir pour 2015, son entrée en vigueur n'est pas prévue avant 2020. Ce calendrier ne permettra pas de limiter le réchauffement à 2°C, puisqu’on manquera la fenêtre d’opportunité pour inverser dès maintenant la tendance, contenir le pic des émissions vers 2015, pour entamer ensuite une décroissance continue jusqu’en 2050. Plus nous retardons la mise en mouvement, plus les efforts à produire seront difficiles à tenir au risque de manquer la cible de moins en 50 % en 2050, signifiant un facteur 4 de réduction pour les pays industrialisés.
Qui plus est, l’accord sur cette feuille de route, reste entaché de très nombreuses incertitudes. Alors que l’Union européenne militait pour un dispositif légalement contraignant, le texte de Durban ouvre trois options : un nouveau protocole ; un instrument légalement contraignant ou un simple « acte juridique ». Outre le temps qui sera encore perdu pour comprendre ce que signifie chaque option et pour en choisir une parmi les trois, il faut craindre que, dans la dynamique de négociation dégradée depuis Copenhague, il sera difficile d’aller au delà de l’option la faible. 2020 verrais alors l’adoption d’un « acte juridique » qui au mieux enregistrera la réalité des réductions des différents pays au regard des engagements pris par les pays signataires. Mais que pourra bien être la portée d’un tel instrument, déconnecté de toute contrainte et de toute sanction. L’observation des relations internationales démontre pourtant que les seuls accords qui comptent vraiment en terme d’engagement sont ceux promulgués par l’OMC, parce que justement ils s’adossent à l’Organe de Règlement des Différends qui juge, émet des sanctions commerciales et veille à leur application.
Une prolongation de Kyoto, alibi, qui masque mal le désarroi de la négociation
Pour combler le gap entre la fin du protocole de Kyoto en décembre 2012, et la mise en œuvre en 2020 de l’accord « à négocier », les états ont adopté le principe d’une deuxième période du protocole de Kyoto de 2013 à 2020. Mais la aussi le diable se cache dans les détails. Avant fin février 2012, les pays devront notifier les mesures qu'ils entendent prendre pour se conformer à leurs objectifs. Sauf que cette deuxième période ne concerne que l'Europe des 27 et la Norvège avec, peut-être, l'Ukraine, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
La Russie, le Japon, le Canada et bien sûr les Etats-Unis qui n'avaient pas ratifié Kyoto1 ne font pas partie de cette prolongation. Qui plus est, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont négocié une formulation de la comptabilisation qui leur permettra de masquer une partie de leurs émissions. Si l’on se rappelle que les Etats membres de l’Union Europe sont déjà engagés par les disposition du paquet Energie - Climat de 2007 (le fameux 3 fois 20), la prolongation avancée comme un acquit majeur de Durban est en fait un non événement.
Le Canada va même jusqu'à annoncé sa sortie du Protocole de Kyoto, trop inquiet de devoir payé des pénalités importantes pour n'avoir pas respecter les engagements pris dès 1997, et trop content de voir se profiler un accord qui lui ne sera jamais douloureux...
Pour combler le gap entre la fin du protocole de Kyoto en décembre 2012, et la mise en œuvre en 2020 de l’accord « à négocier », les états ont adopté le principe d’une deuxième période du protocole de Kyoto de 2013 à 2020. Mais la aussi le diable se cache dans les détails. Avant fin février 2012, les pays devront notifier les mesures qu'ils entendent prendre pour se conformer à leurs objectifs. Sauf que cette deuxième période ne concerne que l'Europe des 27 et la Norvège avec, peut-être, l'Ukraine, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
La Russie, le Japon, le Canada et bien sûr les Etats-Unis qui n'avaient pas ratifié Kyoto1 ne font pas partie de cette prolongation. Qui plus est, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont négocié une formulation de la comptabilisation qui leur permettra de masquer une partie de leurs émissions. Si l’on se rappelle que les Etats membres de l’Union Europe sont déjà engagés par les disposition du paquet Energie - Climat de 2007 (le fameux 3 fois 20), la prolongation avancée comme un acquit majeur de Durban est en fait un non événement.
Le Canada va même jusqu'à annoncé sa sortie du Protocole de Kyoto, trop inquiet de devoir payé des pénalités importantes pour n'avoir pas respecter les engagements pris dès 1997, et trop content de voir se profiler un accord qui lui ne sera jamais douloureux...
Nouveaux sujets et nouveaux risques
Si l’on peut être satisfait que la question agricole soit enfin inscrite comme un sujet important des négociations, il faudra là aussi rester vigilent pour que l’ouverture de ce débat ne soit pas à nouveau l’occasion d’une marginalisation accrue des plus vulnérables. Il faudrait, pour éviter cela, doter les pays en développement de moyens suffisants pour leur permettre de mesurer les impacts des modèles d’exploitation mixant agriculture et élevage. On serait probablement surpris de l’efficacité de ces systèmes traditionnels et de la rentabilité d’un investissement qui consisterait à venir en aide aux agricultures paysannes. Là aussi « il faut et il suffit » d’opérer des choix politique majeurs, en rupture avec les habitudes, pour tester les alternatives et faire droit aux initiatives de terrain. C’est dans cette double efficacité – efficacité climatique et efficacité budgétaire – que l’on pourrait trouver le ressort d’une nouvelle révolution agricole.
De la même façon, un accord devra être trouvé sur les forêts et les émissions dues aux changements d'affectation des sols et au secteur forestier : LULUCF, dans le jargon de la négociation pour Land Use, Land-Use Change and Forestry. Après des années de négociations ardues, les modalités de comptabilisation des impacts dans ce domaine semblent être stabilisées. Mais un nouveau danger pointe sur le secteur forestier, dans le mesure où les LULUCF pourraient donner accès au marché carbone, alors que de nombreux points doivent encore être clarifiés : quels seront mécanismes de contrôle de la réalité des « changements d’affectation » faisant l’objet de négociation ? Quel sera le retour concret pour les sylviculteurs ou les agriculteurs ? La mise en marché n’aura-t-elle pas pour effet indirect de favoriser la déforestation de certains territoires ?
Si l’on peut être satisfait que la question agricole soit enfin inscrite comme un sujet important des négociations, il faudra là aussi rester vigilent pour que l’ouverture de ce débat ne soit pas à nouveau l’occasion d’une marginalisation accrue des plus vulnérables. Il faudrait, pour éviter cela, doter les pays en développement de moyens suffisants pour leur permettre de mesurer les impacts des modèles d’exploitation mixant agriculture et élevage. On serait probablement surpris de l’efficacité de ces systèmes traditionnels et de la rentabilité d’un investissement qui consisterait à venir en aide aux agricultures paysannes. Là aussi « il faut et il suffit » d’opérer des choix politique majeurs, en rupture avec les habitudes, pour tester les alternatives et faire droit aux initiatives de terrain. C’est dans cette double efficacité – efficacité climatique et efficacité budgétaire – que l’on pourrait trouver le ressort d’une nouvelle révolution agricole.
De la même façon, un accord devra être trouvé sur les forêts et les émissions dues aux changements d'affectation des sols et au secteur forestier : LULUCF, dans le jargon de la négociation pour Land Use, Land-Use Change and Forestry. Après des années de négociations ardues, les modalités de comptabilisation des impacts dans ce domaine semblent être stabilisées. Mais un nouveau danger pointe sur le secteur forestier, dans le mesure où les LULUCF pourraient donner accès au marché carbone, alors que de nombreux points doivent encore être clarifiés : quels seront mécanismes de contrôle de la réalité des « changements d’affectation » faisant l’objet de négociation ? Quel sera le retour concret pour les sylviculteurs ou les agriculteurs ? La mise en marché n’aura-t-elle pas pour effet indirect de favoriser la déforestation de certains territoires ?
Dépasser les déceptions et les rancœurs
Y-a-t-il une lueur au bout du tunnel de la négociation ? Peut être pas. Mais l’espoir pourrait venir d’une porte latérale, ou plutôt de deux ouvertures auxquelles les négociateurs n’avaient pas vraiment pensé.
La première concerne la problématique énergétique, qui, en quelque sorte, force la porte de la négociation climatique. D’une part, le renchérissement des coûts du pétrole et du gaz, du fait de la raréfaction de ces ressources, conduit à de nouvelles considérations sur l’économie d’un développement qui mettrait en avant la sobriété et l’efficacité énergétique et l’essor massif des énergies renouvelables. D’autre part, l’accident de Fukushima a mis fin à un certain angélisme sur le fait que le nucléaire constituait une solution facile pour alimenter les grandes métropoles et les grands centres industriels très consommateurs d’énergie et souvent très émetteurs de GES ? Au delà de la vulnérabilité une nouvelle fois révélée de cette technologie, les coûts à court, moyen et long terme de la catastrophe donnent le tournis et forcent à penser différemment les logiques d’investissements pour donner progressivement la priorité aux stratégies dites de « non regret. »
De nombreux débats ont, à Durban, renforcés la légitimité de l’Europe qui se trouve positionnée, peut être sans l’avoir vraiment voulu, en moteur de la réflexion sur la transition énergétique. Les conférences et autres « side events » organisés, en particulier par l'Allemagne, ont rencontré un très vif succès. Cette approche de la transition énergétique tend à rebattre les cartes en passant progressivement d’une logique de contrainte – réduire les émissions pour tenir les engagements et ne pas être pénalisés sur le marché (encore à venir) du carbone – à une logique d’opportunité – créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois et de nouveaux modèles de gouvernance en organisant une nouvelle politique de l’énergie dont un des effets « secondaires » sera de réduire considérablement les émissions de GES.
La deuxième bonne nouvelle vient des territoires qui sans attendre le résultats des négociations climat qu’ils suivent depuis des années, ont engagé sur le terrain des stratégies d’atténuation et d’adaptation qui commencent à porter leur fruit. Si les impacts de ces efforts sont encore difficilement perceptibles dans la comptabilisation des engagements nationaux, les effets au niveau local sont bien réels : plans de déplacement urbains favorisant le report modal en faveur des mobilités douces et des transports collectifs ; développement d’un urbanisme moins consommateurs d’espace, plus efficace énergétiquement et finalement plus agréable à vivre ; redynamisation de l’économie locale autour de programmes ambitieux de rénovation énergétique du bâti existant ; mobilisation citoyenne pour inviter tous les acteurs à participer aux arbitrages nécessaires à l’émergence d’une société plus sobre en carbone… Si les grandes villes ont été assez tôt à la manœuvre pour animer et promouvoir ces politiques ; les Régions et les Etats Fédérés rentrent maintenant en action. La première Conférence Européenne des Régions engagées pour le climat, organisée en Octobre 2011, à Lyon, par la Région Rhône Alpes en collaboration avec le Climate Group et nrg4SD, réseaux des gouvernements régionaux pour le développement durable, est une illustration de cette mobilisation croissante. Les Régions ont pu à cette occasion échanger leurs bonnes pratiques et affirmer l’intérêt que soit mieux pris en compte leurs capacités, mais aussi leurs contraintes, pour mettre en œuvre les mesures concrètes qui contribueront à la réduction des émissions de GES sur les territoires.
Y-a-t-il une lueur au bout du tunnel de la négociation ? Peut être pas. Mais l’espoir pourrait venir d’une porte latérale, ou plutôt de deux ouvertures auxquelles les négociateurs n’avaient pas vraiment pensé.
La première concerne la problématique énergétique, qui, en quelque sorte, force la porte de la négociation climatique. D’une part, le renchérissement des coûts du pétrole et du gaz, du fait de la raréfaction de ces ressources, conduit à de nouvelles considérations sur l’économie d’un développement qui mettrait en avant la sobriété et l’efficacité énergétique et l’essor massif des énergies renouvelables. D’autre part, l’accident de Fukushima a mis fin à un certain angélisme sur le fait que le nucléaire constituait une solution facile pour alimenter les grandes métropoles et les grands centres industriels très consommateurs d’énergie et souvent très émetteurs de GES ? Au delà de la vulnérabilité une nouvelle fois révélée de cette technologie, les coûts à court, moyen et long terme de la catastrophe donnent le tournis et forcent à penser différemment les logiques d’investissements pour donner progressivement la priorité aux stratégies dites de « non regret. »
De nombreux débats ont, à Durban, renforcés la légitimité de l’Europe qui se trouve positionnée, peut être sans l’avoir vraiment voulu, en moteur de la réflexion sur la transition énergétique. Les conférences et autres « side events » organisés, en particulier par l'Allemagne, ont rencontré un très vif succès. Cette approche de la transition énergétique tend à rebattre les cartes en passant progressivement d’une logique de contrainte – réduire les émissions pour tenir les engagements et ne pas être pénalisés sur le marché (encore à venir) du carbone – à une logique d’opportunité – créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois et de nouveaux modèles de gouvernance en organisant une nouvelle politique de l’énergie dont un des effets « secondaires » sera de réduire considérablement les émissions de GES.
La deuxième bonne nouvelle vient des territoires qui sans attendre le résultats des négociations climat qu’ils suivent depuis des années, ont engagé sur le terrain des stratégies d’atténuation et d’adaptation qui commencent à porter leur fruit. Si les impacts de ces efforts sont encore difficilement perceptibles dans la comptabilisation des engagements nationaux, les effets au niveau local sont bien réels : plans de déplacement urbains favorisant le report modal en faveur des mobilités douces et des transports collectifs ; développement d’un urbanisme moins consommateurs d’espace, plus efficace énergétiquement et finalement plus agréable à vivre ; redynamisation de l’économie locale autour de programmes ambitieux de rénovation énergétique du bâti existant ; mobilisation citoyenne pour inviter tous les acteurs à participer aux arbitrages nécessaires à l’émergence d’une société plus sobre en carbone… Si les grandes villes ont été assez tôt à la manœuvre pour animer et promouvoir ces politiques ; les Régions et les Etats Fédérés rentrent maintenant en action. La première Conférence Européenne des Régions engagées pour le climat, organisée en Octobre 2011, à Lyon, par la Région Rhône Alpes en collaboration avec le Climate Group et nrg4SD, réseaux des gouvernements régionaux pour le développement durable, est une illustration de cette mobilisation croissante. Les Régions ont pu à cette occasion échanger leurs bonnes pratiques et affirmer l’intérêt que soit mieux pris en compte leurs capacités, mais aussi leurs contraintes, pour mettre en œuvre les mesures concrètes qui contribueront à la réduction des émissions de GES sur les territoires.
Prochaine escale : Doha
Dans un monde de plus en plus marqué par la primauté de la communication et de l’affichage, les symboles prennent une importance croissante. Comment dans ce contexte, ne pas s’inquiéter que la prochaine étape de la Conférence des parties à la convention climat, soit Doha, capitale du Qatar, état pétrolier par excellence. Symbole toujours, comment ignorer qu’en parallèle à la COP 17 de Durban se tenait au Qatar, justement, le 20ème Congrès mondial du pétrole, comme une démonstration supplémentaire de la toute puissance de l’industrie des énergies fossiles, après l’inscription d’une étape qatari au championnat du monde Formule 1 et l’attribution de la prochaine coupe du monde de football à un pays à peine doté d’une équipe d’envergure régionale ?
Les lobbys du pétrole et du gaz œuvrent depuis des années à affaiblir la négociation internationale sur le climat. Ils ont tout fait pour préserver les 450 milliards de dollars de subventions publiques (chiffres de l’OCDE) qui chaque année soutiennent le développement des énergies fossiles, celles là même dont nous devrions apprendre à nous passer ! Ces lobbys auront les portes grandes ouvertes au Qatar, leur quartier général. Comment peut-on imaginer que le sursaut, si nécessaire à la négociation climat, vienne de cette étape ? Que peut-on espérer d’une présidence qui bat les records d'émissions de CO2 par habitant, nie l’existence des syndicats, bafoue les droits essentiels des femmes et interdit l’engagement des ONG ?
Dans un monde de plus en plus marqué par la primauté de la communication et de l’affichage, les symboles prennent une importance croissante. Comment dans ce contexte, ne pas s’inquiéter que la prochaine étape de la Conférence des parties à la convention climat, soit Doha, capitale du Qatar, état pétrolier par excellence. Symbole toujours, comment ignorer qu’en parallèle à la COP 17 de Durban se tenait au Qatar, justement, le 20ème Congrès mondial du pétrole, comme une démonstration supplémentaire de la toute puissance de l’industrie des énergies fossiles, après l’inscription d’une étape qatari au championnat du monde Formule 1 et l’attribution de la prochaine coupe du monde de football à un pays à peine doté d’une équipe d’envergure régionale ?
Les lobbys du pétrole et du gaz œuvrent depuis des années à affaiblir la négociation internationale sur le climat. Ils ont tout fait pour préserver les 450 milliards de dollars de subventions publiques (chiffres de l’OCDE) qui chaque année soutiennent le développement des énergies fossiles, celles là même dont nous devrions apprendre à nous passer ! Ces lobbys auront les portes grandes ouvertes au Qatar, leur quartier général. Comment peut-on imaginer que le sursaut, si nécessaire à la négociation climat, vienne de cette étape ? Que peut-on espérer d’une présidence qui bat les records d'émissions de CO2 par habitant, nie l’existence des syndicats, bafoue les droits essentiels des femmes et interdit l’engagement des ONG ?
Il faudra un réveil des forces citoyennes d’une rare ampleur pour inverser cette tendance et pour que les dirigeants, et les lobbies qui les pressent, comprennent qu’un autre chemin est possible, un chemin qui mettrait en avant la sobriété et l’efficacité énergétique, l’innovation technologique, le développement des énergies renouvelables et la mobilisation des territoires. Ce chemin est le seul possible pour préserver le climat planétaire et relancer une dynamique économique positive créatrice de nouvelles richesses et de nouveaux emplois. Il nécessite surtout une prise de responsabilité collective et individuelle, des consommateurs aux chefs d’entreprises, des citoyens aux responsables des grandes institutions, des électeurs aux chefs de gouvernements, pour que tous prennent la mesure du défi climatique, premier enjeu planétaire à solidarité obligatoire !
Déjà en 2007, lors de la campagne présidentielle, la construction de l’EPR avait été l’objet de fortes tensions. Les débats opposaient alors pro et anti à l’intérieur même du parti socialiste. Conseiller de Ségolène Royal, j’avais du batailler dur pour arracher l’arbitrage aboutissant à la déclaration d’une « mise à plat du dossier ». Cinq ans, après les positions restent bloquées sur les mêmes arguments, en dépit d’un contexte radicalement différent… Que peut-on retenir de ces balbutiements de l'histoire politico-nucléaire?
Avant même le démarrage officiel de la campagne, en décembre 2006, tout le monde avais compris le caractère symbolique d’une déclaration concernant la nécessité de sursoir, ou pas, au développement de la tête de série du nouveau réacteur EPR à Flamanville. Je ne me souviens plus du nombre d’argumentaires qu’il a fallut produire pour tenter de trouver un accord. Je me rappelle en revanche très bien que c’est par la concertation que j’ai pu finalement faire bouger les lignes.
Tentant de m’appuyer sur la position officielle des députés socialistes qui avaient voté contre la décision du gouvernement UMP d’engager la construction de l’EPR, j’ai essuyé ma première déconvenue. Ces élus m’ont gentiment expliqué qu’ils n’avaient voté contre que parce qu’ils savaient que leur opposition seraient sans effet et qu’ils pouvaient donc se permettre ce coup d’esbroufe sans mettre en danger un projet auquel il restaient, sur le fond très attachés. Toujours la même antienne : la grandeur industrielle de la France, l’excellence atomique hexagonale, la souveraineté énergétique…
J’ai pourtant réussi avec François Brottes, député de l’Isère et grand connaisseur des questions énergétiques à monter une concertation. Nous avons, ensemble, audité près de trente experts de divers horizons. Il en avait choisi 10, j’en avais recruté 10 également et, nous en avions conjointement identifié une autre dizaine. Bien évidemment, ce panel éclectique allait de responsables d’Areva aux spécialistes de Greenpeace en passant par divers experts d’EDF, de RTE, des associations, du mouvement Négawatt et du Syndicat des Energies Renouvelables. Au terme de ces auditions, c’est François Brottes qui a tiré le premier la conclusion qu’il était urgent d’attendre. Aucun argument, ni énergétique – un soit disant besoin de produire plus d’électricité –, ni industriel – l’urgence de faire la démonstration que l’EPR, ça marche – n’avait pu le convaincre de la nécessité de poursuivre la construction de l'EPR. Notre autre conclusion était que la décision de construire, ou pas, un nouveau réacteur, ne se présenterait impérativement aux décideurs qu’autour de 2015 – 2020.
La communication de notre recommandation – arrêter le chantier de Flamanville qui n'en n'était qu’aux fondations – avaient alors suscité, vous l’imaginez, de nombreuses réactions. Eric Besson, qui était encore socialiste – au moins par son adhésion au PS – avait été particulièrement injurieux, méprisant mon travail mais aussi celui de ses pairs. D’autres, dont le premier secrétaire de l’époque et candidat officiel aujourd’hui ont été plus subtil en proposant l’idée de la « mise à plat » du dossier. Cette posture prudente aura finalement été retenue et annoncé en direct au journal de France 3 à Caen, à quelques kilomètres de Flamanville.
J’ai pourtant réussi avec François Brottes, député de l’Isère et grand connaisseur des questions énergétiques à monter une concertation. Nous avons, ensemble, audité près de trente experts de divers horizons. Il en avait choisi 10, j’en avais recruté 10 également et, nous en avions conjointement identifié une autre dizaine. Bien évidemment, ce panel éclectique allait de responsables d’Areva aux spécialistes de Greenpeace en passant par divers experts d’EDF, de RTE, des associations, du mouvement Négawatt et du Syndicat des Energies Renouvelables. Au terme de ces auditions, c’est François Brottes qui a tiré le premier la conclusion qu’il était urgent d’attendre. Aucun argument, ni énergétique – un soit disant besoin de produire plus d’électricité –, ni industriel – l’urgence de faire la démonstration que l’EPR, ça marche – n’avait pu le convaincre de la nécessité de poursuivre la construction de l'EPR. Notre autre conclusion était que la décision de construire, ou pas, un nouveau réacteur, ne se présenterait impérativement aux décideurs qu’autour de 2015 – 2020.
La communication de notre recommandation – arrêter le chantier de Flamanville qui n'en n'était qu’aux fondations – avaient alors suscité, vous l’imaginez, de nombreuses réactions. Eric Besson, qui était encore socialiste – au moins par son adhésion au PS – avait été particulièrement injurieux, méprisant mon travail mais aussi celui de ses pairs. D’autres, dont le premier secrétaire de l’époque et candidat officiel aujourd’hui ont été plus subtil en proposant l’idée de la « mise à plat » du dossier. Cette posture prudente aura finalement été retenue et annoncé en direct au journal de France 3 à Caen, à quelques kilomètres de Flamanville.
L’accord scellé hier entre EELV et le PS nous ramène donc à cet état de 2007, où le PS dit, sans le dire vraiment, qu’il ne sait plus quoi faire de cette « patate chaude » qu’est devenu l’EPR. Car enfin, comment qualifier de projet d’avenir un chantier qui a mi-parcours a vu son coût et sa durée de réalisation multiplier par deux ? Comment soutenir cette option technologique dont les fondements en matière de sécurité sont remis en cause par les autorités concernées en France, en Grande Bretagne et en Finlande ? Comment surtout, après Fukushima, refuser d’étudier sérieusement l’hypothèse d'une sortie du nucléaire et comment justifier, alors, la construction d’une nouvelle unité de production électronucléaire dont on a aucun besoin dans les 10 ans qui viennent.
Le courage en politique devrait être aussi de reconnaître que l’on a pu se tromper, que le contexte à changer, et que ce qui était hier un projet d’avenir, peut-être dès aujourd’hui un projet dépassé. Le courage se devrait être de faire l’analyse approfondie des tenants et des aboutissants en écoutant sereinement toutes les positions, en respectant tout autant la parole des citoyens que celles des experts de l’industrie.
On a beaucoup dit que François Hollande n’avait rien lâché pour affirmer son « autorité présidentielle ». Il se pourrait bien que l’autorité sans courage n’ait aucun sens. Gageons que le candidat socialiste saura faire preuve d’une nouvelle forme d’autorité, une autorité qui affirme, avec courage, la grandeur de reconnaître qu’on ait pu se tromper.
On a beaucoup dit que François Hollande n’avait rien lâché pour affirmer son « autorité présidentielle ». Il se pourrait bien que l’autorité sans courage n’ait aucun sens. Gageons que le candidat socialiste saura faire preuve d’une nouvelle forme d’autorité, une autorité qui affirme, avec courage, la grandeur de reconnaître qu’on ait pu se tromper.
De passage à New York, et partant à la rencontre des militants de OWS - Occupy Wall Street -, je suis tombé sur une manifestation des 99% faisant le lien entre le bas et le haut de Manhattan pour mobiliser la "Grosse Pomme" par les deux bouts. Le contraste devient confrontation quand la manifestation débouche sur Times Square, temple par exemple de la publicité tapageuse au service d'une hyper consommation particulièrement ravageuse...

Les manifestations de rue aux Etats Unis n'ont pas grand chose à voir avec les cortèges français. Le regroupement de 200 personnes cheminant de Wall Street à Central Park est perçu à New York comme une grosse mobilisation, quand 100 fois plus de monde dans une manifestation parisienne ferait pâle figure. Mais peu importe le nombre, c'est surtout l'éclectisme des manifestant qui surprend : des jeunes et des moins jeunes, des syndicalistes avertis, casque de chantier rivé sur la tête, et des mères de familles avec enfants, poussettes et cabas, des retraités et des jeunes cadres dynamiques "potentiels". Tous s'assemblent dans un attroupement à la fois bon enfant et très expressif, chacun ou presque y allant de sa pancarte. Ainsi cette femme d'une quarantaine d'année qui défile en reprenant à peine les slogans scandés par ses voisins, mais qui brandi haut et fort un carton sur lequel elle a inscrit avec un mauvais marker : "NY tax payer for 23 years" "Contribuable new-yorkais depuis 23 ans". Un slogan qui dit juste le ras le bol de ces "américains moyens" fatigués de contribuer à un système qui les ignore ou les broie.
Mais la pancarte qui m'aura le plus frappé est celle-ci : "Do not rob the poor just because you can".. "Ne volez pas les pauvres, juste parce que vous le pouvez". Slogan pathétique dirons certain, ou signe profond de rejet du modèle libéral qui justement laisse aux puissants la possibilité de prendre tout ce qu'ils peuvent aux moins puissants.
Mais la pancarte qui m'aura le plus frappé est celle-ci : "Do not rob the poor just because you can".. "Ne volez pas les pauvres, juste parce que vous le pouvez". Slogan pathétique dirons certain, ou signe profond de rejet du modèle libéral qui justement laisse aux puissants la possibilité de prendre tout ce qu'ils peuvent aux moins puissants.
La longévité de l'occupation de Wall Street est remarquable, surtout quand on la compare aux difficultés rencontrées par les militants français pour tenter l'occupation de l'esplanade de la Défense à Paris, symbole équivalent à la célèbre rue de Manhattan. De la même façon, les sondages (CBS News / New York Times) montrant que 43 % des américains soutiennent les points de vue défendus par les occupants de Wall Street, devraient donner espoir à tous les militants de la transformation écologique et sociale de notre société.

Pourtant, il reste difficile d'être optimiste en constatant le fait que la mobilisation garde un caractère très marginal.
La semaine dernière les organisateurs de OWS ont tenté de promouvoir un essaimage du mouvement dans tous le pays. Si l'on peut saluer le fait que près d'une centaine de manifestations ont eu lieu de Chicago à Los Angeles, force est de constater que le nombre de manifestants reste au total très bas pour ce pays de 300 millions d'habitants. Ainsi, à peine une douzaine d'universités ont pris part à la mobilisation. Et même en Californie, que l'on doit considérer comme une référence en matière de démarche progressiste, la State University de Bakersfield n'a pu rassembler plus de 140 étudiants pour un sit-in de quelques heures.
Le contraste auquel j'ai été confronté en croisant à Times Square la manifestation des 99% est édifiant. Quand cette troupe éclectique marche d'un bon pas pour faire le lien entre le bas (Wall Street) et le haut (Central Park) de Manhattan, les passants venus jouir des lumières de Times Square tournent à peine la tête. Certains applaudissent pour soutenir les protestataires, mais la très grande majorité restent concentrés sur l'itinéraire qui les mène inéluctablement vers la galerie marchande la plus proche... Nous sommes et nous restons au coeur du temple de la consommation... Et la publicité étincelante d'une boisson gazeuse devenue le symbole de l'Amérique qui gagne, qui nous propose de "nouvelles façon de penser, de nouvelles possibilités" semble se moquer de ces militants bien désuets dans cet environnement qui célèbre le commerce triomphant.
La semaine dernière les organisateurs de OWS ont tenté de promouvoir un essaimage du mouvement dans tous le pays. Si l'on peut saluer le fait que près d'une centaine de manifestations ont eu lieu de Chicago à Los Angeles, force est de constater que le nombre de manifestants reste au total très bas pour ce pays de 300 millions d'habitants. Ainsi, à peine une douzaine d'universités ont pris part à la mobilisation. Et même en Californie, que l'on doit considérer comme une référence en matière de démarche progressiste, la State University de Bakersfield n'a pu rassembler plus de 140 étudiants pour un sit-in de quelques heures.
Le contraste auquel j'ai été confronté en croisant à Times Square la manifestation des 99% est édifiant. Quand cette troupe éclectique marche d'un bon pas pour faire le lien entre le bas (Wall Street) et le haut (Central Park) de Manhattan, les passants venus jouir des lumières de Times Square tournent à peine la tête. Certains applaudissent pour soutenir les protestataires, mais la très grande majorité restent concentrés sur l'itinéraire qui les mène inéluctablement vers la galerie marchande la plus proche... Nous sommes et nous restons au coeur du temple de la consommation... Et la publicité étincelante d'une boisson gazeuse devenue le symbole de l'Amérique qui gagne, qui nous propose de "nouvelles façon de penser, de nouvelles possibilités" semble se moquer de ces militants bien désuets dans cet environnement qui célèbre le commerce triomphant.
Reste encore beaucoup à faire pour que cette base des 99% que veulent représenter les occupants de Wall Street se mobilise effectivement et qu'elle donne rapidement corps à un réel mouvement de masse. Gardons l'espoir, en nous rappelant que la démocratie de s'use que si l'on ne s'en sert pas !
Bruno Rebelle |
|
 |
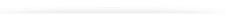 en France et à l'international  |
Catégories
Derniers billets
Nuage de tags
Agenda
Agriculture
Agro-alimentaire
Bio
Carbone
Climat
Collectivités
Danone
déchets nucléaire
Démocratie
Ecologie politique
Energie
ENR
Entreprises
Europe Ecologie
Fiscalité
G20
Grande Distribution
Grenelle
Inde
Jaitapur
Marcoule
Nucléaire
ONG
Politique
Principe de précaution
Répression
RSE
Social
Solaire
Derniers tweets
Archives
Le Blog de Bruno Rebelle © 2010











 Ma bio
Ma bio
Billets / Tribunes
| Par Bruno REBELLE | Mardi 13 Décembre 2011 à 12:11 | 0 commentaire